Colmar em Elsaß |
|||||
|
Le meuble héraldique y est indiqué comme étant une molette d'éperon (partie de gueules et de sinople, à la molette d'éperon d'or, attachée à sa branche, posée en bande). Le champ de l'écu de cette ville est quelquefois blasonné diapré, assez fréquent dans les armoiries allemandes; cela provient sans doute des feuillages dont on chargeait autrefois le fond des écussons héraldiques. Selon une description de 1531, il s'agirait d'un rapprochement de Kolben (= la masse d'armes en allemand), et columbarium (= colombier en latin - qui donna le nom à la ville). La première mention assurée de Colmar se trouve dans un diplôme de 823, accordé par Louis le Pieux. Et plus sur le développement de la ville de Colmar du IXe au XIIe siècle... Selon la tradition populaire, ce serait la massue que Hercule aurait oubliée à Colmar, sous l'effet du vin. En effet, Hercule après avoir franchi les Vosges, par la route déjà suivie par Bacchus au temps ou il avait enseigné à nos anciens l'art de planter la vigne. Hercule arriva un soir à Colmar pour se reposer des fatigues de la route. Il reprit des forces en goutant les vins de la régions et il s'assoupit. Pour rattraper le temps perdu, dans son empressement, il oublia d'emporter sa fameuse massue, encore conservée comme témoin du passage d'Hercule en Alsace dans les armes de Colmar. Et plus... Quelques liens sur Colmar :
et sur son histoire...
À lire : Acker P. (1910). Une ville alsacienne Colmar. Revue des deux Mondes, tome 59, p. 664-688. Betz J. (1961). Colmar à travers les textes du XXe siècle. Annuaire de la Société historique et littéraire de Colmar, 11, 118-128. Kammerer O. (1990). Colmar et Fribourg à la fin du Moyen-Âge : convergences et divergences. Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Colmar, 4, 33-45. Lerse F. (1856). Geschichte der Einführung der Reformation in der ehemaligen freien Reichstadt Colmar und ihrer Folgen bis zum Jahr 1632: aus den besten gedruckten und ungedruckten Quellen geschöpft. Decker, Colmar, 232 p. Leuilliot P. (1950). Le protestantisme alsacien. Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 5e année, 3, 315-333. Livet G., dir. (1983). Histoire de Colmar. Privat, Toulouse, 332 p. [compte-rendu] Metz B. (2002). Essai sur la hiérarchie des villes médiévales d'Alsace (1200-1350) [1e partie]. Revue d'Alsace, 128, p. 47-100. Waltz A. (1902). Bibliographie de la ville de Colmar. Jung, Colmar, 539 p. Waltz A. (1961). Les sceaux et armoiries de la ville de Colmar - avec Note complémentaire par P. Martin. Annuaire de la Société historique et littéraire de Colmar, 11, 7-24. Publications luthériennes : Colmarisches verbessertes Gesangbuch mit einem Anhange von Gebeten, 2. Ausgabe, Decker, Colmar (1807), 82 p.+ 408 p. Colmarisches Lutherisches Lob-Opffer, oder Neuverbessertes Kirchen- Schul- Hausz- und ReiszGesang-Buch, in welchem... die Geist- Lehr- und Trost-reicheste Lieder, Psalmen und Lobgesänge D. Martin Luthers und anderer reiner und frommer Lehrer, auf das neue mit besonderm Fleisz zusammen getragen, enthalten sind. Sampt einem nutzlichen und bequemen Gebett-Büchlein... Decker, Colmar (1722), 44 p. + 584 p. |
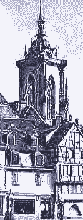  Dans les troubles du XIVe siècle, l'union entre villes impériales alsaciennes au sein du saint Empire Romain Germanique est indispensable, et, en 1354 Charles IV ratifie officiellement la fameuse Dekapolis (Décapole), dont les autres villes les plus proches sont Kaysersberg, Turckheim, Munster. À gauche, la cathédrale St-Martin, vue des Dominicains ; à droite, la maison Pfister, sise rue des Marchands, en face du Musée Bartholdi. Au XVIe siècle, le couvent des Dominicaines (Unterlinden) est réputé pour la qualité de sa vie spirituelle. Martin Schongauer a peint La Vierge au buisson de roses, tandis que Matthias Grunewald a peint son admirable retable pour le couvent proche d'Issenheim (aujourd'hui au musée des Unterlinden à Colmar). En 1575, la ville passe au protestantisme par la volonté de l'oligarchie municipale protestante, dont des ancêtres directs et des cousins, comme les Stettmeister Hans Goll, Michael Buob, le Gerichtschreiber Andreas Sandherr, des plus actifs à imposer la Réforme luthérienne (voir liens ci-dessous). De fait, Colmar n'a compté aucun réformateur, et les laïques y jouèrent un rôle modérateur plus efficace que les théologiens souvent autoritaires. Les caractères spécifiques de son protestantisme furent : prédominance de la collectivité des fidèles, libéralisme, constitution démocratique (Leuilliot, 1950). Et plus sur la Réforme à Colmar Lors de la Guerre de Trente Ans, Louis XIV installe des troupes à Colmar en 1635 et il obtient au traité de Westphalie la cession de la Décapole et de toutes les possessions alsaciennes des Habsbourg. En 1673, Louis XIV rase ses fortifications, puis Colmar est rattachée à la France par le traité de Riswick, en 1697. En 1698, la culture française et la religion catholique sont imposées. Colmar redevient allemande suite au traité de Francfort (1871) jusqu'au traité de Versailles (1919) mettant fin à la Première Guerre mondiale, puis en 1940 avec l'annexion de l'Alsace au Troisième Reich lors de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1945.
Nos ancêtres directs ou cousins de familles patriciennes de Colmar se découvrent au fur et à mesure de l'extension de nos recherches généalogiques. Nombreux étaient ces notables, bourgeois colmariens, qui ont joué un rôle primordial dans le développement de la ville, ils étaient Stettmeister (régent de la ville) et/ou Obritsmeister (bourgmestre), membres du Wagkeller, et possédaient des maisons aujourd'hui monuments historiques. Au moment de la Réforme, ils en furent d'actifs militants jusqu'à son application en 1575 par le Conseil de la ville.
L'église Saint-Matthieu, une ancienne église franciscaine construite en 1292, devient propriétaire de la ville en 1543. La Réforme luthérienne est introduite à Colmar en 1575 par nos ancêtres et cette église est mise à la disposition des luthériens : le premier culte est célébré le 15 mai par le pasteur Johannes Cellarius. Sauf entre 1627 et 1632, incluant la Contre-Réforme, l'usage luthérien s'est poursuivit jusqu'à nos jours. L'orgue installée en 1732 par Andreas Silbermann est monument historique depuis 1986. |
|||
|
|||||



